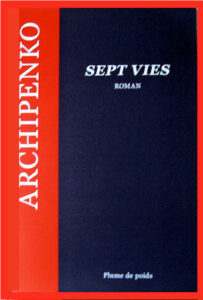– Ça ne veut rien dire comme ça! Je te regarde comme un homme qui te désire; comme ça, simplement…
– Te rends-tu compte de lâge qui nous sépare, de mon physique de quinquagénaire que me renvoie ton image?
– Ce n’est pas un état-civil dont j’ai envie. Et tes yeux me renvoient justement mon image comme jamais je ne l’ai ressenti. C’est pour ça que je te veux!
Le vent des cons !
Petit à petit, le paysage changeait sur la toile du Grand Architecte de l’Univers, par touches infimes, successives. La Cadière d’Azur, sur son piton élevé, s’éveillait aussi à la promesse d’une journée balayée par le vent. Le massif de la Sainte-Victoire pagnolisait sous le pinceau éternel de Paul Cézanne. Le petit Marcel du Château de ma mère était mort depuis longtemps. Il repose dans le petit cimetière de La Treille, face au Taoumé, tournant le dos à la fontaine de Manon des sources.
Déjà la vie économique réelle du pays flirtait avec la montagne ; les zones portuaires, aéroportuaires et industrielles de Marseille montraient leur ventre d’activité, au détour d’un lacet de l’autoroute. Massalia, la vieille, l’antique, le vagin éternel de cette France de vingt siècles. Marseille, ce n’est pas les Bouches du Rhône, mais son vagin écartelé dans un delta aussi large, et aussi flamboyant qu’un tableau de Gustave Courbet, voire de Modigliani.
Vagin pénétré par tous les peuples du monde, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, de l’antiquité à nos jours, les Italiens, les Espagnols, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens de l’immigration moderne, voulue par manque de bras autochtones, pour reconstruire la France de l’après-guerre. Marseille la salope, de plus en plus éloignée de son hymne patriotique, polluée par des adeptes de la barbe et de l’aliénation des femmes. Où es-tu soldat en guenille de l’armée du Rhin, dont le chant galvanisa tout un peuple en armes, contre les tyrans, les rois, les envahisseurs venus de Coblence, Franconiens des exils en or ?
Déjà, la voiture s’était engagée sur son axe nord, en s’incrustant dans la circulation de l’autoroute du Sud. Cornas n’allait pas tarder à se profiler. Lui aussi sur son python, ce village annonçait les côtes du Rhône et leur couleur vermillon, carmin, rouge sang, écarlate, violette, selon l’endroit, où la vigne est entretenue par des générations du savoir faire, du savoir transmettre, de pères en fils accrochés à leur sol, aussi noueux que les ceps qu’ils exploitaient.
Il restait encore quelques heures avant d’arriver à Paris.
*** Je venais de conclure une enquête dans les milieux glauques de l’extrême droite varoise, en ce qui concerne le volet policier pour lequel j’avais été détaché par mon bureau. Une sommité d’un parti qui aspire à gouverner ce pays avec une poigne de fer, avait été assassinée le 29 août, dans des conditions d’une ressemblance avec les méthodes qu’il prônait de son vivant : violentes et très musclées. L’enquête avait duré huit semaines, cinquante-quatre jours exactement.
Des jours et des heures, à tenter de reconstituer un puzzle, où toutes les chausse-trappes étaient permises, où les coups tirés venaient de tous les horizons politiques, affairistes, et mafieux.
Ma tâche n’avait pas été facile dans ce sens où beaucoup de monde, trop de monde, cherchait à protéger la victime, que ce fut parmi ses propres amis, pas tous, et davantage à l’intérieur de certains des partis politiques institutionnalisés du sud de la France.
Je n’avais arrêté personne non plus, même si je fus présent lors de l’arrestation des protagonistes. Ce n’était pas mon rôle.
Le travail pour lequel on m’avait envoyé dans le midi était achevé. La consigne consistait à transmettre le relais au Service Régional de Police Judiciaire, le SRPJ, voire au juge d’instruction chargé de l’enquête, dûment chapitré par la Chancellerie, ce ministère de la Justice d’où émanaient toutes les instructions politiques, quel que soit le régime en place.
La fréquentation, pour les nécessités de l’enquête, des milieux pétainistes m’avait perturbé. J’éprouvais le besoin de me nettoyer l’esprit et le corps de cette gangue ; comme si j’étais infecté, affecté, par le revêtement d’une tunique de Nessus, de toutes les retombées des pourritures de cette enquête.
Depuis Fréjus je n’avais jamais dépassé la vitesse limite, roulant à mon train, bien au-dessous de celle autorisée ; je n’étais pas pressé. J’écoutais une vieille cassette, l’adagietto de la symphonie N°5 en ut dièse mineur de Gustav Mahler, me remémorant par la même occasion le film Mort à Venise, et son ambiance pesante et glauque dont Visconti a su habilement nous donner une idée des odeurs pestilentielles des égouts de la ville et de la maladie qui y rôdaient. Glauque, tout y est glauque. Moins pesant et moins glauque en tous les cas que cette affaire.
Décidément tout m’y ramenait ! Il allait me falloir une thérapie !
Peut-être, pour ce faire, qu’un jour je coucherai par écrit ce que j’avais vu, ce que j’avais fait. Cela serait salutaire pour moi, mais également pour tous ceux qui ont les yeux fermés devant la montée en puissance du borgne !
Excédé, repoussant à un moment plus propice l’écoute du chef d’œuvre de Mahler, j’insérai une cassette du groupe Creedence Clearwater Revival, années soixante-dix, qui entama par Rumble tramble.
*** Cornas était déjà loin depuis une heure et demi. Je pris la décision, en apercevant le panneau Saint-Étienne, de m’arrêter à Givors, à vingt kilomètres au sud de Lyon.
À la lecture du nom de cette commune, je souriais intérieurement. En effet, Givors fut pendant de longues années, la ville des tricards, des assignés à résidence du département du Rhône.
Tout ce qui composait le monde interlope des maquereaux, auteurs de vol à main armée, cambrioleurs, voleurs à la tire, après quelques années à purger leur peine à Saint-Paul, la prison de la cité des lumières, que les utilisateurs de l’autoroute connaissent, pour en longer les murs, le long du Rhône, à Lyon, se retrouvaient assignés à résidence dans cette cité ouvrière. Il ne fallait pas effrayer les grandes familles lyonnaises des Remparts d’Ainay, quartier de la très grande bourgeoisie lyonnaise.
Alors, dehors ! Raus ! Weiss ! ouste ! la lie de la société, les traîne-savates, les prostituées et les maquereaux ! Merci monsieur le juge, merci monsieur le commissaire de police, merci monsieur le préfet. Tous à Givors qui n’avait malheureusement jamais demandé que lui fût conférée un tel honneur !
Il n’était pas rare dans l’entre-deux-guerres, de retrouver entre Giers et Rhône, le cadavre d’un de ces assignés, flottant entre deux eaux, plus ou moins vert selon le temps de séjour en eau, lesté comme il se doit de béton. Ces morts relevaient le plus souvent de règlements de comptes entre ceux qui avaient pris la succession sur le haut du pavé, les nouveaux maîtres du milieu lyonnais et les has-been givordins. Nul n’est prophète en son pays ; et à vingt kilomètres de Lyon, on n’était plus, à cette époque, dans son pays !
***
Yann était un ancien cheminot. Sa mère, Quitterie, avait été blanchisseuse à Miniac-Morvan au début du 20e siècle. Son père, Pierrick, également cheminot, originaire de Saint-Malo, fût affecté successivement au chemin de fer du Midi puis, pour cause de grève dure, muté disciplinairement à la compagnie Paris-Lyon-Marseille, le PLM1, en 1937, en poste à la gare de Grigny-Badan.
Yann était né à Grigny, alors petit village entre Rhône et Givors. Il y avait grandi, et était devenu un solide gaillard, suffisamment bâti pour aller travailler sur les bogies de la Bête humaine.
La nature lui avait fait don d’un regard bleu, de ce bleu que l’on ne voit qu’en Bretagne, pétillant constamment, d’une ironie remplie de tendresse pour ses semblables, et cependant capable de se durcir face à l’adversité. En 1957, il avait épousé Mercotte une fille de journaliers de Montbrison, dans la Loire, que la révolution industrielle avait poussée près des chemins de fer de la compagnie du P.L.M.
Leur seul drame était de ne jamais avoir eu d’enfant. Alors, ils les avaient adoptés au fil du temps, au fil des passages des uns et des autres, au fil des placements de la DASS2, au fil du Rhône proche, enfants devenant adultes à leur tour.
Je savais, que de tous, et encore aujourd’hui, j’étais l’enfant, primus inter pares. Malgré le temps qui s’écoule, malgré le début de blanchiment de mes cheveux, malgré les vicissitudes de cette fin de siècle qui n’en finit pas de crever, je restais leur enfant. Ils m’aimaient. Je les aimais ; il n’en fallait pas plus.
Yann et Mercotte avaient tous les deux placé les quelques économies, accumulées sous après sous, francs après francs, pendant des années, pour acheter cet hôtel-restaurant de la lointaine banlieue industrielle de Lyon.
À l’époque des autoroutes de l’information, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, du smartphone, de la tablette, de l’icloud, de Facebook, de Tweeter, cette période de l’industrie florissante n’évoque plus rien ou presque plus rien pour beaucoup d’entre nous. Elle relève du passé de la boîte à images en noir et blanc, diffusées de temps à autre par quelques programmes de chaînes de télévision ne cherchant pas systématiquement l’audimat.
Pourtant, ni Yann ni Marjorie n’ont jamais été nostalgiques du chemin de fer. Tout juste évoquent-ils de temps à autre, quelques anecdotes, histoire de se remémorer essentiellement les amis et compagnons de travail, les galères, les grèves mémorables, où l’esprit de solidarité et de fraternité avait un sens ; où l’on partageait la soupe et le pain, où ceux qui avaient un jardin, faisaient pot commun de leur production de légumes et de quelques fruits, selon les saisons[…]
Les chambres de l’hôtel, meublées de lits anciens, ont toujours eu cette odeur de sent bon, l’odeur des draps qui séjournaient préalablement dans un placard rempli de lavande fraîche, de la vraie lavande, celle qu’on va ramasser, à la saison, du coté de Grignan, dans les pas de la marquise de Sévigné, dans la Drôme, pas tant éloignée que ça des confins du Rhône.
[…]Mercotte venait de temps à autre me porter quelques potions amères, et surtout beaucoup de chaleur.
Marjorie, que tout un chacun des familiers appelle la Reine Mercotte, est au fourneau. À l’instar de toutes les cuisinières lyonnaises que l’on surnomme les mères, la Mère Brazier, la Mère Jean, la Mère Levrat, elle n’a d’autre formation que son savoir-faire. Dire qu’elle cuisine bien est un doux euphémisme. Dans ce siècle de communication tous azimuts, Mercotte n’a pas besoin de campagnes publicitaires orchestrées pour attirer le client. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Le dimanche, en famille, les citadins se rendent chez la Reine Mercotte pour y déguster quelques-unes des lyonnaiseries.[…] Dimanche 19 novembre 1995
Il faisait bon. La Renault 25 avalait l’asphalte de l’autoroute depuis Fréjus que je quittais au petit matin déjà brumeux de cet automne qui n’en finissait pas de vouloir ressembler à un été aboulique, dans les senteurs de la Provence. Les odeurs de pins maritimes concurrençaient les champs de lavande éloignés de toutes mouillères. Elles s’étalaient en mer violacée, battues par le vent du midi, venu du Sahara, le vent des fadas.